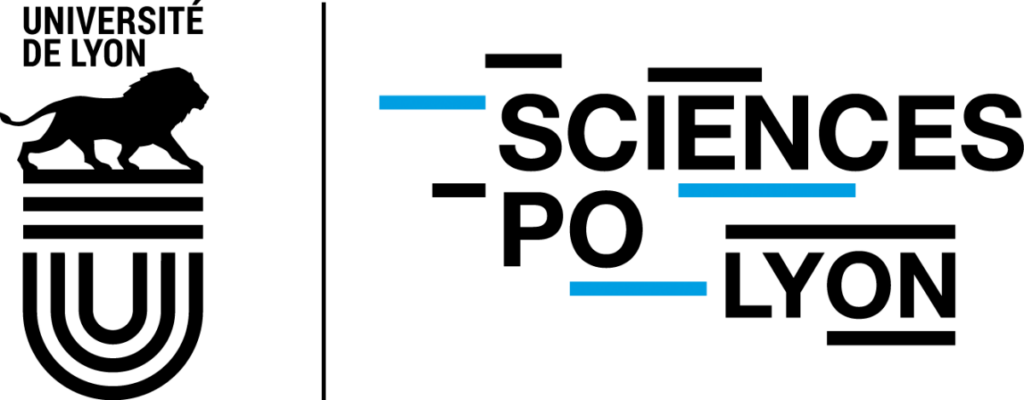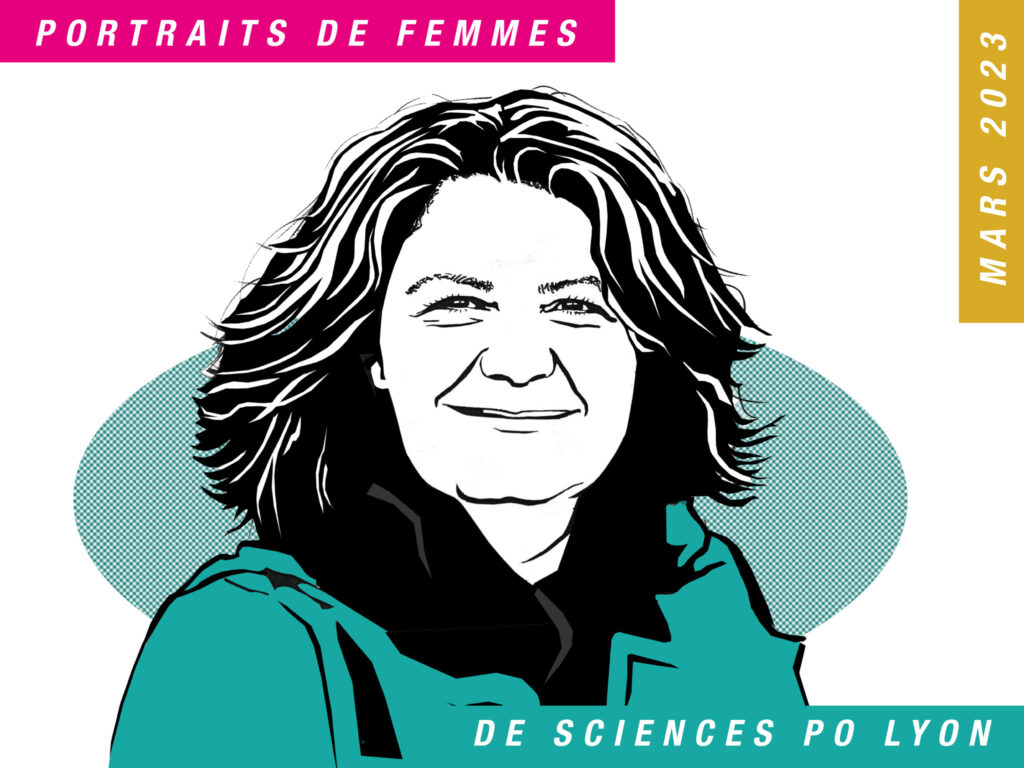Découvrez le 1er portrait de la série “Portraits de femmes de Sciences Po Lyon”.
À l’occasion du 8 mars, découvrez le premier portrait de la série “Portraits de femmes de Sciences Po Lyon”.
Isabelle Garcin-Marrou
Professeure des universités en sciences de l’information et de la communication à Sciences Po Lyon.
Pouvez-vous nous présenter qui vous êtes ainsi que votre parcours professionnel ?
Je suis Isabelle Garcin-Marrou, je suis enseignante-chercheure en sciences de l’information et de la communication, depuis 1998 et Professeure des Universités dans cette discipline depuis 2007.
J’ai fait des études tout d’abord de philosophie, puis, au moment de ce qui est maintenant le master 2, j’ai bifurqué en sciences de l’information et de la communication et j’ai ensuite réalisé une thèse qui portait sur le traitement médiatique du terrorisme en France et en Grande-Bretagne (j’avais fait une année de master of Philosophy en Ecosse et j’avais alors découvert le traitement médiatique de ce qui était, encore, la guerre en Irlande du Nord). J’ai soutenu cette thèse à l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3, en 1995, puis je suis revenue (pour des raisons personnelles) en région Rhône-Alpes et, en 1997, je suis devenue ATER à l’IEP de Lyon (Sciences Po Lyon), pour une année. J’ai eu la chance d’y être ensuite élue comme maîtresse de conférences puis comme professeure. Depuis cette arrivée à Sciences Po Lyon, j’ai fait beaucoup de choses, tant institutionnelles, que pédagogiques ou de recherche. Je dirige depuis 10 ans l’Équipe de recherche de Lyon en sciences de l’information et de la communication, ELICO, dont Sciences Po Lyon est une des tutelles institutionnelles. Je continue à enseigner et mener des recherches sur les discours médiatiques qui traitent d’événements touchant au social et au politique (les violences envers les femmes ou des femmes, le terrorisme, les discours qui stigmatisent les territoires périphériques).
Est-ce qu’être une femme a eu une incidence pour vous dans votre trajectoire professionnelle ?
L’incidence n’a pas été immédiate parce que, à la différence de beaucoup de collègues femmes, j’ai été formée par des collègues (hommes) extrêmement respectueux, bienveillants et pour qui le travail universitaire n’était pas un lieu du rapport de forces (ou de domination). Il y a bien eu cependant quelques congrès où, jeune doctorante, je devais faire attention et repousser les avances de collègues, installés, qui avaient des comportements plus que problématiques. Mais nous étions, dans ces congrès, en “bande” de copines doctorantes et nous faisions bloc (la sororité, qui n’était pas formulée comme telle, était là et nous servait de bouclier). L’incidence était alors qu’il n’était pas envisageable de partir “seule” dans un colloque lointain.
Ces incidences, je les ai affrontées de façon plus systématique, plus tard, une fois devenue enseignante-chercheure, en me heurtant à des remarques sexistes ou en étant en position de faiblesse récurrente dans des situations de conflits. La violence du rapport des hommes à leurs collègues femmes, dans le milieu universitaire, s’est aussi accentuée au fur et à mesure que j’avançais dans la carrière et elle s’est révélée assez notable quand je suis devenue professeure et que j’ai pris des responsabilités institutionnelles.
Mais ces années ont été aussi celles de ma formation plus solide au féminisme ; je me suis donc aussi armée, intellectuellement, pour résister même si, comme beaucoup de collègues femmes, j’ai rencontré au moins une situation d’humiliation qui m’a valu un arrêt de travail. J’avais beau être outillée pour comprendre, quand on subit un rapport de force brutal, même dans les mots, il est difficile de s’en sortir sans casse. Et je suis tout à fait certaine que je n’aurais pas du tout vécu ces rapports de force si j’avais été un homme.
Comment avez-vous vécu l’évolution des luttes pour les droits des femmes au cours de votre carrière ?
Je les ai vécues positivement et j’en ai pris ma part ; par exemple, j’ai été une des premières femmes, enseignante-chercheure, à me bagarrer, dans l’établissement, pour que mon congé maternité soit reconnu comme un congé entraînant des droits (qui ne supposait donc pas que l’on rattrape les heures non faites !). Ce n’était pas automatique et il a fallu se battre (et nous étions, alors 3 ou 4 femmes dans l’effectif d’enseignant·es-chercheur·es à Sciences Po Lyon). Mais mon cas a fait jurisprudence informelle et mes collègues qui sont passées après ont bénéficié de cette jurisprudence qui s’est ensuite stabilisée par la formulation réglementaire des effets du droit à congé maternité par le ministère.
L’évolution des luttes s’est élargie aussi à la prise en compte des discriminations, y compris pour les étudiant·es ; l’apparition récente des cellules qui œuvrent à la prévention (et à la prise en charge) des violences sexistes et sexuelles est une excellente chose, même si beaucoup reste à faire dans les mentalités, dans les comportements. Mais l’énergie des jeunes collègues et des étudiant·es sur ces questions me donne beaucoup d’espoir et d’énergie, aussi.
Et puis, l’arrivée progressive de collègues femmes dans ma discipline et plus généralement dans l’enseignement supérieur et la recherche (ESR), si elle n’est pas une garantie de bien s’entendre, a quand même généralement comme conséquences que les espaces de travail sont beaucoup moins ceux de rapports sexistes… et je dois dire que ces effets des luttes sont à savourer lorsqu’ils sont visibles.
Cette évolution a aussi été celles des travaux universitaires et du développement très fort, en France, des études de genre et des travaux sur les femmes (je coordonne régulièrement une enquête sur la place des femmes dans les médias et j’enseigne sur les questions de genre / journalisme / médias).
Les luttes sont donc administratives, syndicales, sociales, politiques et intellectuelles, et c’est aussi un signe très positif pour moi de voir émerger une « jeune » recherche sur ces questions de féminisme (entre autres), avec des thèses formidables, réalisées par des jeunes chercheuses qui seront, je l’espère, nos successeures dans l’ESR.
Y a-t-il des femmes qui ont été des modèles pour vous ou qui vous ont inspirée ?
Oui, il y en a ; pas énormément (car ma discipline était fort peu féminisée au début de ma thèse puis de ma carrière). Mais il y a une collègue, toulousaine, Marlène Coulomb-Gully (je la cite nommément car elle a beaucoup compté dans ma trajectoire professionnelle) qui, quand les conflits étaient rudes pour moi en 2007, m’a embarquée dans des travaux collectifs sur les femmes dans les médias. Nous sommes devenues des amies et sa sûreté intellectuelle, son humour, sa capacité à faire du collectif m’ont beaucoup aidée et, aussi, inspirée. C’est avec elle que mes recherches ont pris un tour féministe plus marqué, et il y a eu là, pour moi, un effet que nous décrivons comme le fait de « chausser des lunettes de genre », qui m’ont renforcée aussi dans mon attention aux enjeux multiples de la place et de la condition des femmes.
Et puis des collègues, femmes, il y en a eu de plus en plus et si je ne peux pas toutes les citer, je dois dire que c’est un plaisir, depuis quelques toutes petites années, de fréquenter les collectifs de recherche, les congrès, et de voir des collègues, plus jeunes, qui portent des recherches, des collectifs formidables. Les femmes qui m’inspirent sont donc aussi, et pour beaucoup d’entre elles, des chercheuses dont j’ai pu accompagner ou voir arriver les travaux ; ce sont ces femmes qui avancent dans la recherche qui m’inspirent aussi, fortement.
Si on vous dit “Lutte pour les droits des femmes” que répondez-vous en 3 mots ?
Cruciale, toujours d’actualité, et nécessairement intersectionnelle !